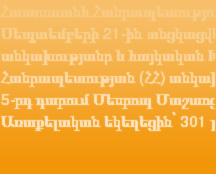AFAJA : Association Française des Avocats et Juristes Arméniens
DINK : LE VERDICT EST TOMBE, LA JUSTICE ATTENDRA
 Depuis l’audience du 29 juillet 2011 où les avocats de la partie civile avaient mis en évidence la présence d’une équipe opérationnelle assistant Ogün Samast, la Cour s’est empressée de mettre un terme à ce procès alors que l’instruction aurait dû être relancée.
En relaxant le 17 janvier 2012 les 19 prévenus du chef de participation à une organisation terroriste en relation avec l’assassinat de Dink, la Cour d’Assises d’Istanbul valide la thèse officielle en ne retenant que la culpabilité de Yasin Hayal comme commanditaire, dans l’exécution du rédacteur en chef d’Agos.
Retour sur les six derniers mois d’audience qui ont décrédibilisé la justice turque. Notes d’audience de l’AFAJA.
Depuis l’audience du 29 juillet 2011 où les avocats de la partie civile avaient mis en évidence la présence d’une équipe opérationnelle assistant Ogün Samast, la Cour s’est empressée de mettre un terme à ce procès alors que l’instruction aurait dû être relancée.
En relaxant le 17 janvier 2012 les 19 prévenus du chef de participation à une organisation terroriste en relation avec l’assassinat de Dink, la Cour d’Assises d’Istanbul valide la thèse officielle en ne retenant que la culpabilité de Yasin Hayal comme commanditaire, dans l’exécution du rédacteur en chef d’Agos.
Retour sur les six derniers mois d’audience qui ont décrédibilisé la justice turque. Notes d’audience de l’AFAJA.
 Le verdit doit tomber, la justice peut attendre.
Plus qu’une intuition, c’est bien le sentiment amer qui se dégageait à l’issue de l’audience du 19 septembre 2011 au procès des complices de l’assassin de Hrant Dink.
Alors qu’on s’attendait à une relance de l’instruction depuis la démonstration apportée par les avocats de la partie civile lors de la précédente audience, qu’une équipe opérationnelle assistait Ogün Samast le jour de l’assassinat du journaliste turc d’origine arménienne, la Cour a cru devoir inviter le Procureur Hilmet Usta à prononcer son réquisitoire.
Cette accélération inopportune du procès conduira Rakel et Hosrov Dink, épouse et frère de la victime, à quitter l’audience en signe de protestation, tout comme l’ensemble des avocats de la partie civile, la Cour démontrant par cette nouvelle décision qu’elle n’était pas curieuse d’en apprendre davantage.
Tout en assurant que son analyse pourrait évoluer en fonction de l’avancement de l’enquête, le représentant du Ministère public a requis la prison à vie contre Yasin Hayal et Ehran Tuncel, présentés comme les
Le verdit doit tomber, la justice peut attendre.
Plus qu’une intuition, c’est bien le sentiment amer qui se dégageait à l’issue de l’audience du 19 septembre 2011 au procès des complices de l’assassin de Hrant Dink.
Alors qu’on s’attendait à une relance de l’instruction depuis la démonstration apportée par les avocats de la partie civile lors de la précédente audience, qu’une équipe opérationnelle assistait Ogün Samast le jour de l’assassinat du journaliste turc d’origine arménienne, la Cour a cru devoir inviter le Procureur Hilmet Usta à prononcer son réquisitoire.
Cette accélération inopportune du procès conduira Rakel et Hosrov Dink, épouse et frère de la victime, à quitter l’audience en signe de protestation, tout comme l’ensemble des avocats de la partie civile, la Cour démontrant par cette nouvelle décision qu’elle n’était pas curieuse d’en apprendre davantage.
Tout en assurant que son analyse pourrait évoluer en fonction de l’avancement de l’enquête, le représentant du Ministère public a requis la prison à vie contre Yasin Hayal et Ehran Tuncel, présentés comme les
 commanditaires de « cet assassinat prémédité » et « dirigeants de la cellule de l’organisation terroriste Ergenekon à Trabzon ».
Cette référence inattendue à Ergenekon de la part du parquet résonnait comme l’aveu d’une instruction volontairement bâclée pour ne pas dire tronquée.
commanditaires de « cet assassinat prémédité » et « dirigeants de la cellule de l’organisation terroriste Ergenekon à Trabzon ».
Cette référence inattendue à Ergenekon de la part du parquet résonnait comme l’aveu d’une instruction volontairement bâclée pour ne pas dire tronquée.
Après s’être systématiquement opposé pendant quatre années aux requêtes de la partie civile exigeant la jonction de la procédure Dink avec celle bien connue sous le nom d’Ergenekon, le procureur reconnaissait finalement que cette organisation derrière laquelle se cacherait « l’Etat profond » était impliquée dans l’assassinat du rédacteur en chef d’Agos.
Dink était donc l’une des victimes de ce vaste plan de déstabilisation mené par cette nébuleuse ultranationaliste regroupant hauts fonctionnaires, officiers, policiers, gendarmes, avocats et journalistes et qui a pris également pour cible le prix Nobel de Littérature Orhan Pamuk, le journaliste Hincal Uluç sans parler de l’attentat du Mc Donalds
 de Trabzon qui a scellé la rencontre entre Yasin Hayal et Erhan Tuncel.
Mais loin d’apaiser la douleur de la famille Dink, cette reconnaissance tardive ne pouvait que raviver sa colère.
de Trabzon qui a scellé la rencontre entre Yasin Hayal et Erhan Tuncel.
Mais loin d’apaiser la douleur de la famille Dink, cette reconnaissance tardive ne pouvait que raviver sa colère.
Pourquoi avoir refusé à plusieurs reprises tant la mise en cause que la simple audition des gendarmes de Trabzon et notamment leur responsable, Ali Öz, poursuivis uniquement pour négligences administratives alors que les éléments du dossier montrent qu’ils étaient informés du projet criminel mais n’ont rien fait pour l’empêcher, s’abstenant de transmettre toute information à leur hiérarchie ? Pourquoi dénoncer la destruction de preuves par la police de Trabzon sans pour autant exiger l’élargissement de l’enquête sur ces faits et leur jonction avec le procès des assassins de Dink et leurs complices ?
Pourquoi toujours s’être opposé tant à la mise en cause qu’à la simple audition du vice-président du MIT (services secrets de l’armée), Özel Yilmaz, aujourd’hui inculpé dans l’affaire Ergenekon, lequel avait fait comprendre à Hrant Dink « qu’il allait payer » pour avoir publié un article révélant que la fille adoptive d’Atatürk était une orpheline arménienne, menaces proférées suite à la convocation du Directeur d’Agos à la Préfecture d’Istanbul, en présence du Préfet Muhammer Güler et de son bras droit Ergun Günger ?
Pourquoi enfin le Ministère public, autorité de poursuite, n’a-t-il pris aucune initiative depuis plus de quatre ans pour faire progresser l’instruction, laissant les avocats de la famille Dink rechercher seuls les témoignages, vidéos et éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité alors qu’il s’est au contraire montré extrêmement diligent dans la procédure Ergenekon en multipliant investigations, recherches, perquisitions, interrogatoires, inculpations et incarcérations de personnalités importantes jusque parmi les généraux de l’armée ?
La justice n’est décidément pas la même en Turquie selon que la victime est arménienne ou pas.
Ces réquisitions ambivalentes et en trompe l’œil annonçaient en réalité l’ouverture du dernier acte de ce feuilleton judiciaire.
La 14ème chambre de la Cour d’Assises d’Istanbul décidait d’enchaîner et accélérer les audiences, abandonnant toute velléité d’instruction, invitant les parties « à lire leurs plaidoiries » les 14 novembre, 5 et 26 décembre 2011, puis 10 janvier 2012 pour finalement rendre son verdict le 17 janvier suivant avec pour unique ambition d’en terminer avant le 5ème anniversaire de l’assassinat du rédacteur en chef d’Agos. Or au cours de ces six derniers mois, la Cour aurait pu tout au contraire se donner les moyens d’identifier de nouveaux complices d’Ogün Samast par l’examen des registres téléphoniques que la Haute Autorité des Communications (TIB), après moult manœuvres dilatoires, avait fini par verser aux débats.
La résistance de la TIB à diffuser ces informations et le traitement qui par la suite en sera fait par la section antiterroriste du Parquet sont révélateurs du déni de justice qui marquera définitivement ce procès.
A l’issue de l’audience du 29 juillet 2011, le montage vidéo présenté par Me Fethiye Cetin mettait en évidence la présence d’au moins trois personnes présentes sur les lieux du crime depuis la fin de la matinée, en soutien à Ogün Samast, et qui avaient régulièrement passé des appels depuis leur téléphone portable.
Accédant à la demande des avocats de la partie civile, la Cour avait demandé à la TIB de communiquer la liste des appels passés à proximité du siège de l’hebdomadaire Agos le jour de l’attentat. La TIB a dans un premier temps refusé d’y faire droit, s’abritant derrière l’atteinte à la vie privée qu’entrainerait une telle diffusion, argument sera rejeté par un arrêt intermédiaire de la Cour rendu au mois de septembre 2011.
Dans un second temps, la TIB a prétendu qu’elle ne conservait que les communications supérieures à trois minutes alors que d’autres instructions en cours démontraient le contraire, puis a invoqué la nécessité d’opérer des tests préliminaires pour identifier les antennes susceptibles de capter les appels téléphoniques passés depuis le quartier du Sisli où l’attentat s’est produit.
A l’audience du 14 novembre 2011, Me Bahri Belen avait fustigé les motifs fallacieux opposés par la TIB, autorité parfaitement compétente pour identifier les antennes concernées par les appels litigieux et stigmatisait ses manœuvres dilatoires dont le but était de tenir encore 64 jours, période après laquelle son obligation de conservation des archives relatives au 19 janvier 2007 serait prescrite…
Finalement et sous la pression des médias et d’une partie de la société civile dénonçant ce indécent stratagème, la TIB diffusait le 2 décembre 2011 une liste d’appels passés à proximité du siège d’Agos avant et après le meurtre, composée de 6.235 conversations téléphoniques et 9.300 numéros de téléphones, sans pour autant constituer, comme l’a dénoncée l’avocate Féthiye Cetin, la liste exhaustive des appels émis et reçus durant la période sollicitée.
Ce rebondissement n’allait cependant pas modifier le comportement ni le calendrier de la Cour qui a rejeté la demande de report présentée par les avocats de la partie civile pour leur permettre d’examiner ces documents, invitant ces derniers à plaider dès le 5 décembre.
Au cours de l’audience du 26 décembre 2011, le Procureur de la république, Hikmet Usta déclarait qu’après vérification, la section antiterroriste du Parquet concluait que les registres fournis par la Haute Autorité des Télécommunication (TIB), ne contenaient aucune conversation téléphonique en rapport avec les 19 personnes accusées d’appartenance à une organisation terroriste à l’origine du meurtre de Hrant Dink.
Or dès l’audience suivante, le 10 janvier 2012, les avocats de la famille Dink démontraient le contraire : au moins 5 personnes ont eu, le jour et sur les lieux du meurtre, des conversations téléphoniques directes avec les accusés Mustafa Öztürk et Salih Hacisalihoglu.
Et Me Fethiye Cetin d’interpeller le Parquet : « Même nous, avec le peu de moyens et de temps dont nous disposons, nous sommes parvenus à établir ce lien. La réponse de la police d’Istanbul prouve bien qu’elle a depuis le début essayé d’étouffer l’affaire »
Fort de cette démonstration embarrassante pour le Ministère public, Me Cetin s’adressant cette fois au Président Rüstem Eryilmaz, lui demandait de saisir ces registres ainsi que ceux des 18 et 19 janvier 2007 appartenant aux opérateurs couvrant le quartier, en rappelant le risque de destruction de preuves par la TIB.
Mais la Cour a une nouvelle fois fui ses responsabilités, transmettant l’examen de cette requête au parquet d’Istanbul qui officiellement, continue l’enquête !
La plaidoirie des avocats de la famille Dink s’est tenue sur deux audiences, les 5 et 26 décembre 2011, en l’absence volontaire de Rakel, Delal et Hosrov Dink refusant de cautionner davantage ce spectacle judiciaire.
Certainement tentés dans un premier temps par une stratégie de rupture, lorsque la Cour a refusé de relancer l’instruction après l’audience du 29 juillet, Féthiye Cetin et le collectif d’avocats qui s’est constitué autour d’elle ont finalement décidé de plaider. Plaider pour dénoncer l’instruction tronquée et le refus d’instruire du Parquet, le maquillage et la disparition de preuves entre les mains de la section antiterroriste du Parquet d’Istanbul ou de la Police de Trabzon, l’incapacité à retrouver pendant quatre ans des témoins essentiels et les entendre à l’audience, le refus de coopération des autorités administratives (TUBITAK et TIB) avec l’autorité judiciaire. Plaider aussi pour protester contre le renoncement de la Cour d’Assises d’Istanbul à faire la lumière sur un crime qui a profondément marqué la société civile turque mais également l’opinion publique internationale. Mais au delà des éléments matériels du dossier, les avocats de la partie civile ont insisté sur l’importance de ce rendez-vous entre la Justice turque et les Arméniens en replaçant ce procès dans son véritable contexte historique pour soulever la question du sort des minorités sous l’Empire ottoman et les reflexes ataviques des juridictions turques à leur égard : « le meurtre de Hrant Dink ne peut pas être conçu comme un acte commis par trois ou quatre jeunes épris par la provocation, mais comme un homicide nourri depuis plus d’un siècle par une hostilité systématique » dénoncera Me Barhi Belen.
Le processus qui a conduit l’assassinat du journaliste arménien est ensuite détaillé.
La publication le 6 février 2004 par Agos d’un article révélant que la fille adoptive de Mustafa Kémal Atatürk était une orpheline ayant échappé au génocide arménien résonnait comme une injure intolérable pour les milieux nationalistes turcs. Dès le 22 février 2004, le Conseil national de sécurité diffusait un communiqué affirmant « que les minorités deviennent une menace pour la sécurité nationale » pour conclure « qu’un suivi de leurs activités était conseillé ».
Cette seule déclaration annonçait la mise à mort de Hrant Dink. Insultes, campagnes de presse, menaces, poursuites sur le fondement de l’article 301 du Code pénal et condamnations s’en sont suivis. En donnant lecture à l’audience des deux dernières chroniques de Dink « Pourquoi a-t-on fait de moi une cible ? » et « Mon état d’âme est celui d’une colombe inquiète », publié par Agos les 12 et 19 janvier 2007, jour de son assassinat, la partie civile rappelait que la victime avait pleinement conscience du processus criminel se refermant contre elle.
Soutenus par la présence solidaire des délégations des Barreaux de Paris et Bruxelles composées de Me Elise Arfi, Me Alexandre Couyoumdjian et du Bâtonnier Yves Ochinsky ainsi que par des représentants des barreaux anatolien de Mersin (Me Halil Hulki Özel), Siirt (Me Mehmet Cemal Acar), Bitlis (Me Enis Gül), Van et Sirnak (Me Nusirevan Elçi), Mardin (Me Azad Yildrim), Agri (Me Heval Sinan Aras), Bingöl (Me Erdal Aydemir), les avocats de la famille Dink s’adressaient à la Cour dans une ultime interpellation : « Quoi qu’il arrive, votre juridiction va laisser une trace dans l’histoire. Soit elle sera celle qui brisera cette tradition et instaurera à nouveau confiance en la justice, soit elle poursuivra la tradition des assassinats politiques et des hostilités. La décision vous appartient. »
Le jugement a finalement été rendu le mardi 17 janvier 2011, juste avant le 5ème anniversaire de l’assassinat de Hrant Dink. La Cour s’est visiblement ancrée dans la tradition séculaire d’hostilité à l’égard des minorités en abandonnant la veuve, les enfants et frères du journaliste arménien dans un nouveau déni de Justice. Yasin Hayal sera reconnu comme l’unique commanditaire de l’attentat et condamné à la prison à vie, peine augmentée de 3 mois de prison pour avoir menacé le prix Nobel Orhan Pamuk et à un an de prison et 600 livres turques d’amendes pour possession illégale d’armes.
Erhan Tuncel est quant à lui acquitté pour son implication dans l’assassinat de Dink mais condamné à 10 ans et 6 mois de prison pour sa participation à un attentat contre un Mc Donalds à Trabzon qui avait blessé six personnes en 2004. Il a été remis en liberté le soir même.
Enfin, la Cour relaxe l’ensemble des 19 prévenus du chef de participation à une organisation terroriste en relation avec l’assassinat de Hrant Dink, et dans un réflexe protecteur de l’Etat, valide la thèse improbable d’un assassinat commandité et exécuté par les seuls Yasin Hayal et Ogün Samast, en contradiction avec les réquisitions du procureur.
Le verdict est donc tombé, la Justice attendra.
Alexandre COUYOUMDJIAN, Avocat au Barreau de Paris, Président de l’AFAJA.